Pendant la IVe République
Jusqu'au printemps 1956, les Français ne considèrent pas, malgré le vote de la loi d'urgence que les " événements d'Algérie " (comme il est convenu alors de les appeler) sont un problème très important : en août 1955, 5 % des gens interrogés par l'IFOP sont intéressés à la lecture des nouvelles sur l'Algérie dans leurs journaux.
La prise de conscience de la gravité de la situation en Algérie se réalise au printemps 1956 : 65% des Français pensent que les questions d'Afrique du Nord doivent avoir la priorité du gouvernement. Cette prise de conscience est liée au rappel des disponibles décidé le 11 avril.
Les Français mesurent alors la détérioration de la situation à l'échec de l'appel au cessez-le-feu lancé par Guy Mollet et au nombre d'attentats rapporté dans la presse.
En avril 1956, la question est la suivante : " Si la situation devait beaucoup s'aggraver et que la France n'ait plus le choix qu'entre deux solutions : négocier avec les rebelles pour accorder l'indépendance à l'Algérie ou réprimer l'insurrection en employant tous les moyens militaires, que choisirez-vous ? " L'opinion se partage exactement en deux : 39 % et 39 % avec 22% d'avis non exprimés. Mais en juillet (après que le PCF cesse de soutenir le gouvernement de Guy Mollet), 45 % se prononcent pour des négociations en vue d'accorder l'indépendance et 23 % pour " l'écrasement des rebelles ". Cette prise de position est confortée le même mois : 28 % des Français pensent alors que dans cinq ans l'Algérie ne sera plus française (ne pas oublier l'indépendance du Maroc le 2 mars et celle de la Tunisie le 20 mars qui peuvent faire penser que le sort de l'Algérie penche déjà vers l'indépendance).
Le pourcentage des partisans de l'Algérie française qui atteignait 47 % en 1955 et 49 % en février 1956 décroît ensuite régulièrement : 40 % en avril 1956, 34 % en mars 1957 et 36 % en septembre 1957. En 1957, le problème algérien apparaît à la majorité des Français (51%) comme le problème le plus important pour la France, il l'est pour 62 % des communistes et seulement 47 % des modérés. Si l'on décompose en fonction des appartenances aux partis politiques, en juillet 1957, 89 % des électeurs communistes, 43 % des radicaux, 31 % des socialistes, 35 % des électeurs MRP et 19 % de droit se prononcent pour l'indépendance. Les militaires s'inquiètent de cette situation : le 15 novembre 1957, le général Allard, le commandant en chef des forces terrestres déclare : " Le fait pour le FLN de pouvoir dire qu'il n'y a pas d'unanimité nationale pour le maintien de l'Algérie française est à mon sens, avec l'aide de l'étranger, l'une des causes principales de la prolongation de la lutte en Algérie " (Charles-Robert Ageron).
L'opinion manque de confiance dans les derniers gouvernements de la IVe République, (43 % des Français refusent leur confiance au gouvernement en septembre 1957 par exemple pour conduire des négociations avec l'Algérie), mais rejette également les avis formulés par l'ONU : 50 % contre 18%, 56 % sont favorables à des négociations avec le FLN. Pendant la IVe République
En juillet 1958, 41 % des Français estiment qu'il faudra en venir tôt ou tard à accorder l'indépendance, contre 36 % d'un avis opposé, même si 52 % des Français pensent que l'intégration préconisée par l'armée est une bonne chose, alors que 40 % seulement pensent que celle-ci est possible.
Début 1959, 42 % des Français (et 52 % des hommes) contre 24 % trouvent que l'armée à tendance à dépasser le cadre de ses fonctions normales et 65 % des Français ayant reçu une instruction supérieure sont de cet avis. L'élite s'oppose donc au rôle politique de l'armée. En mai, quand on demande aux Français s'ils se sentent solidaires avec " les populations d'origine européenne qui vivent en Algérie ", 38 % se sentent tout à fait ou assez solidaires contre le même nombre peu ou pas solidaires. Les Français de condition aisée se sentent deux fois plus solidaires que ceux de condition modeste, les cadres deux fois plus que les ouvriers. La conscience d'une solidarité avec les Français d'Algérie varie selon l'âge : elle est minoritaire chez les jeunes et majoritaire chez les personnes âgées de 50 à 64 ans, c'est-à-dire celles qui ont eu 20 ans à l'apogée de l'ère coloniale. C'est le Nord-Ouest de la France qui se sent le plus solidaire, tandis que le Sud-est et la région parisienne sont les moins favorables.
Après le discours du général de Gaulle le 16 septembre 1959 sur le droit à l'autodétermination pour les Algériens, 54 % des Parisiens approuvent ce discours. En décembre, 57 % des Français se déclarent favorables à " des négociations et discussions avec le FLN sur le référendum d'autodétermination ".
43 % des Parisiens considèrent que la semaine des barricades (24 janvier -1e février 1960) a un effet défavorable pour le règlement de la paix en Algérie et 68 % se prononcent pour le général de Gaulle et 70 % sont défavorables à l'action des " Algériens ". Au référendum du 8 janvier 1961 sur l'autodétermination de l'Algérie, De Gaulle qui devait avoir 70% des voix selon les prévisions des instituts de sondage, obtient en fait 72,26 % des suffrages exprimés. Interrogés le 20 mars 1962, au lendemain de la divulgation officielle de la teneur des accords d'Evian, les Français sont satisfaits à 82 %, mais ils savent que tout est loin d'être réglé et ne manifestent pas de joie particulière à saluer une victoire du " peuple algérien " et le 8 avril, les Français approuvent les accords d'Evian par 90,7% des suffrages exprimés.
Quelle est la réaction des Français de métropole envers les Européens d'Algérie ?
En avril 1956, à la question d'un sondage qui demande si les Français sont pour le maintien du statu quo : l'Algérie ensemble de départements français, ou " pour la définition de liens moins étroits ", un tiers des Français se prononce désormais pour des liens " étroits " et en juillet, ils considèrent à 45% que la situation s'est détériorée depuis six mois.
La majorité des Français (51%) désapprouve alors qu'on demande plus d'impôts pour financer " les dépenses d'Algérie ", 48 % refuse qu'on oblige les jeunes à faire leur service militaire en Algérie et 49 % ne veulent pas de l'envoi d'une ou plusieurs classes.
En juillet 1957, pourtant 18 % seulement des Française se déclarent favorables à l'indépendance complète, 34 % favorables à un régime d'autonomie interne dans le cadre français et 36 % fidèles à l'Algérie ensemble de départements français. On mesure ici le décalage entre l'opinion silencieuse et les affirmations des hommes politiques selon lesquels " l'opinion française toute entière est selon Robert Lacoste hostile à l'indépendance " (Jean-Robert Ageron).
Les partisans de l'Algérie française apparaissent donc au début de 1958 comme bien moins nombreux qu'on ne le pensait généralement à l'époque.
Les gouvernements de la IVe République ne savent pas gagner la bataille de l'opinion, acquise à l'idée de la négociation et de la paix.
L'opinion française ne bascule pas en faveur de l'intégration. Si l'on regarde les compositions sociologiques, on peut noter que les cadres et les membres des professions libérales sont les plus nombreux à dire que l'intégration est une bonne chose (52% contre 49 % de la moyenne nationale) mais ils disent aussi que c'est une chose impossible (36% contre 26 % de la moyenne nationale). Il n'y a pas de différence selon les générations.
A la même date, la question algérienne passe au 2e rang des préoccupations des Français et 51% d'entre eux pensent qu'il faudra accorder tôt ou tard l'indépendance. Le clivage est toujours socioprofessionnel et idéologique : 56 % des ouvriers interrogés sont partisans de l'indépendance à terme contre 44% des cultivateurs et 55% des employés contre 40 % des cadres et membres des professions libérales.
Politiquement, 93 % des électeurs du l'UFD (Union des Forces démocratiques), 87 % des électeurs communistes, 64 % des électeurs radicaux et 36 % des électeurs UNR et indépendants modérés.
En mai, près d'un Français sur 5 estime, en dépit des progrès de la " pacification " et des déclarations optimistes du général Challe que la situation a empiré en Algérie et 71 % des Français sont favorables à des négociations en vue d'un cessez-le-feu, taux jamais atteint. L'opinion considère que la guerre est alimentée par l'étranger, l'Egypte, le Tunisie, le Maroc et les pays communistes.
En mars 1960, 64 % des Français trouvent bonne la solution avancée par de Gaulle d'une " Algérie algérienne liée à la France ".
En novembre, 69 % des Français font encore confiance à de Gaulle pour résoudre la question. 56 % croient que l'obstacle principal de la paix est l'intransigeance du FLN, 39 % l'action des pays communistes et 36 % celle des Européens d'Algérie.
Après le putsch des généraux dont l'opinion publique attribue l'échec essentiellement à la détermination du général de Gaulle, celle-ci demande des peines très sévères contre les insurgés (30% la peine de mort).
En août 1961, la majorité des Français (58%) sait que l'Algérie sera un état indépendant et (4% seulement s'affirment encore pour l'Algérie française) mais sans en connaître la date de l'issue, puisqu'en janvier 1962, 28% des Français interrogés pensent que la guerre ne se terminera que dans un, deux ou trois ans, 17 % seulement pensent que ce sera dans quelques mois. A cette date, la majorité des Français (53%) ne se sent plus solidaire des Français d'Algérie.
En juin 1962, ils pensent pour 51 % d'entre eux que les Européens d'Algérie pourront rester en Algérie et quand a lieu l'exode des Pieds-Noirs, 36 % en septembre 1962 considèrent que l'aide accordée par les pouvoirs publics est suffisante, 31 % excessive et 12 % insuffisante.
Ils estiment d'ailleurs à 53% contre 15% que les rapatriés ne font pas ce qu'il faut pour s'adapter à la France métropolitaine.
En mai 1962, 70% des Français acceptent la création d'une république algérienne. Les Français tournent la page de l'Algérie avec soulagement et détermination. Ils enregistrent l'inévitable et passent à autre chose. Ils renforcent aussi l'autorité du général de Gaulle.
Un an après les accords d'Evian, les Français ne savent pas s'ils ont été bien respectés, puisque la moitié d'entre eux s'abstient, mais 41% pensent que le gouvernement français les a respectés et seulement 18% que le gouvernement algérien les a bien appliqués.
professeur au lycée Faidherbe de Lille.
www4.ac-lille.fr/.../Guerre_d_Algerie_et_opinion_publique_M._Ada
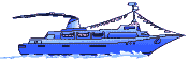 Retour au menu "Période - Raisons"
Retour au menu "Période - Raisons"
Mis en ligne le 24 octobre 2012